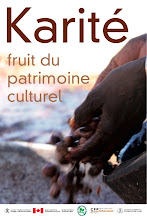Ouf ! Après 12 heures de turbulence dans un autobus surpeuplé et dans lequel la composition de l’air renferme plus de dioxyde de carbone que les salles de gym 24h du quartier gay, je suis finalement de retour à Bamako !
Étant surexploités de façon tout à fait imaginative, les autobus du Mali incarnent le productivisme dominant du pays, voir même de toute l’Afrique de l’Ouest ;-) : des bidons d’eau (sur lesquels certains passagers doivent s’asseoir) encombrent les allées, le toit est surplombé de valises, matelas, poulets (vivants bien sur ! ), poches de riz et de couscous et toute une panoplie de marchandise aussi variée que surprenante. À un point tel que j’en suis venue à la conclusion que les Maliens ont un don prodigieux en ce qui a trait au compactage en des lieux restreints. Je vous assure qu’en terre occidentale, le rendement de ces modestes autobus serait à des années lumières de ce qui est accompli en terre africaine !
Je reviens d’un petit voyage en compagnie de mes co-volontaires canadiens… Nous avons parcouru de nombreux kilomètres et visité 4 villes toutes aussi fascinantes les unes que les autres.

PREMIER ARRÊT : SÉGOU, À 230km DE BAMAKO
Cette petite ville longeant le fleuve Niger est tout à fait charmante dans son atmosphère détendu et authentique. Nous avons séjourné dans un petit hôtel avec vue sur le fleuve; Nous nous sommes promenés dans les rues commerçantes et au marché des potiers ; Nous avons pris une pause sur une terrasse en bordure du fleuve pour admirer le coucher du soleil…
Étant directement sortis du vacarme et de l’agitation de Bamako, il nous fallait ajouter un peu de piquant dans cette petite ville paisible. L’affaire a commencé de façon tout à fait innocente. Nous étions fatigués, affamés, et cherchions un resto où les prix seraient raisonnables et la bière froide. Nous avons trouvé un petit resto éloigné du quartier hôtelier qui semblait répondre à nos exigences. Nous avons tous commandé le poulet grillé, plat assez courant à travers le Mali. 15 minutes passèrent avant que je ne m’impatiente et interpelle le serveur afin qu’il lâche son thé pour prendre notre commande. Jusque-là, les choses se passaient dans un africanisme familier et habituel. 20 minutes passèrent et nous ne pouvions toujours pas confirmer si la bière était bel et bien froide. 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes s’ajoutèrent avant que nos plats arrivent. Finalement ! Nous pouvions nous régaler d’un bon repas bien mérité ! … Hélas, nos espoirs se sont effondrés bien plus rapidement que le service ! L’extérieur du poulet était calciné, l’intérieur cru. Nous sommes restés sur notre faim et avons entrepris la négociation du prix de la facture (au Mali, tout est négociable ! ). Inébranlable, le responsable du resto était aussi rigide que son poulet… et très peu doué en mathématique… héhé. Nous avons réglé la facture et sommes partis comme des fugitifs en fuite ! Notre petit séjour était alors pimenté d’une petite trouille de voir le restaurateur nous traquer dans les petites rues de la ville…
DEUXIÈME ARRÊT : DJENNÉ, A 130km DE MOPTI
Classée au patrimoine de l’Unesco, la ville de Djenné est principalement connue pour son imposante mosquée, qui constitue le plus grand bâtiment construit entièrement de banco, c’est-à-dire de terre crue. D’ailleurs la ville en entier est construite en banco à l’exception des maisons de style marocaines, reconnaissables par leurs portes et leurs fenêtres de bois.
Malgré le fait que la ville perd beaucoup de son charme à cause d’une forte présence touristique, sa légende n’en demeure pas moins fascinante et envoûtante. Fondée au IX e siècle, la ville se situe là où, autrefois, résidaient des "djine" (mauvais esprits). Ceux-ci étaient plutôt réticents à laisser une bande de "bozos" (pêcheurs) s’établir à cet endroit. Ainsi, chaque fois que des constructions étaient entreprises, elles s’effondraient dès le lendemain matin. Après de nombreux échecs, les "bozos" interpellèrent les "djine" afin d’obtenir leur approbation à s’installer sur les lieux. Les djine acceptèrent leur requête, mais à une seule condition : le sacrifice d’une jeune fille unique. C’est alors qu’une jeune fille du nom de « Tapana », n’ayant ni frères ni sœurs, se porta volontaire. Elle fût enterrée vivante et dès lors, les "bozos" entreprirent la construction de la ville de Djenné avec succès. The end … ( À ce qu’il parait, les djine auraient pris la fuite lorsque l’électricité arriva en ville ! )
Ancien centre de l’enseignement islamique, Djenné compte aujourd’hui une quarantaine d’écoles coraniques. Il n’est donc pas rare de rencontrer de jeunes étudiants en train de recopier des passages du Coran sur des surfaces de bois. Seulement, je trouve tellement désolant et déplorant que de voir ces jeunes transcrire et réciter des prières qu’ils ne comprennent même pas, dans une langue qui ne leur appartient pas. Les Maliens prient 5 fois par jour, sans savoir de quoi ils parlent ! C’est à se demander s’ils connaissent vraiment leur Allah vénéré et ça me donne l’impression que leur foi est programmée, superficielle et aveugle.
TROISIÈME ARRÊT : MOPTI
Pour se rendre à Mopti, nous avons pris un taxi-brousse qui peut comporter jusqu’à 9 personnes : 3 sur un banc aménagé à l’arrière, 3 sur la banquette arrière, deux à la place du passager ainsi que le chauffeur. Nous avons logé à l’hôtel « Ya pas de problème » dans un dortoir avec une toilette/douche commune, une petite terrasse privée et une piscine ! C’était du gros luxe comparativement à l’hôtel de Djenné, où le plafond de la toilette s’écroulait sur nos têtes et un petit scorpion perdu a semé la panique dans la chambre des filles !
Située au confluent des fleuves Bani et Niger, Mopti est une ville vivante et agitée. Les touristes y sont aussi très nombreux, mais au moins, ils sont mêlés aux quelques 100 000 habitants. Malgré cela, les guides, commerçants et vendeurs ambulants nous répertorient assez rapidement, de telle sorte qu’il est difficile de faire trois pas sans se faire apostropher.
Après une longue journée de promenade, de marchandage et d’achats, nous avons fait une petite escapade en pirogue. C’était absolument magnifique ! Pendant un instant, je me suis retrouvée à Venise devant la demeure de Marco Polo ! Hehe… je crois que j’ai un peu trop d’imagination…
QUATRIÈME ARRÊT : BANDIAGARA, LA PORTE DU PAYS DOGON
Deux princesses blondes, en l’occurrence Marie-Pierre et moi, sommes parties en duo visiter les « Dogons », un peuple du Mali vivant dans les falaises de Bandiagara. Fuyant l’islamisation, ils y sont arrivés au XIVe siècle, forçant les « Tellems » (peuple de petite taille qui habitait sur les lieux depuis le XIe siècle) à fuir à leur tour. Ces derniers se sont réfugiés au Burkina Faso, mais les sécheresses et les famines entraîneront leur disparition.
Toute ce déplacement n’aura pas servi à grand chose, puisque les Dogons sont aujourd’hui majoritairement musulmans. Ils ont tout de même conservé certaines croyances animistes. Par exemple, si une femme se rend à un endroit réservé aux hommes (et il y en a plusieurs) elle deviendra aveugle …
À ce propos, Marie-Pierre et moi avons visité un village où la circoncision des jeunes garçons se fait sur une colline strictement réservée aux hommes. ( En tant que Toubabou, nous avons pu la visiter puisque les femmes blanches ne semblent pas êtres affectées par l’aveuglement…) Chaque deux ou trois ans, une centaine de garçons se font circoncire, l’un après l’autre, sur cette colline. Afin de limiter l’effroi qu’ils pourraient ressentir, la veille du jour j, ils assistent à la dégustation d’une poule par un boa. Afin de les dissuader de crier durant l’opération, on leur dit qu’ils se feront manger à leur tour s’ils n’obéissent pas … C’est un peu comme notre légende du bonhomme 7 heure… !
Ensuite, c’est la fête durant tout le mois et des festivités sont organisées. Les jeunes garçons font une course jusqu’au sommet de la colline. Le premier gagne un sac de mil, le second un bœuf, et le troisième… je vous laisse deviner. Écrivez vos idées dans la section "commentaires" plus bas !